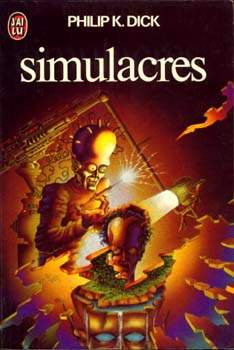PHILIP K.DICK
Les dédales démoniaques de PHILIP K. DICK

Philip K. Dick est né en 1928 à Chicago, et est mort en 1982. Ces dates ne nous disent rien, certainement pas qu'il est en tout cas l'un des grands écrivains de science-fiction de son époque, avec Frank Herbert — Dune et sa suite, L'Incident Jésus, Dosadi —, Samuel Delany — Babel 17, Triton —, Arthur C. Clarke — le trop célèbre 2001, l'Odyssée de l'espace gâché par une grotesque et stupide enfilade d'oeuvres gâteuses —, John Brunner — Tous à Zanzibar — ou Stanislas Lem avec Solaris, porté à l'écran par Tarkovski.
Grand écrivain, Dick ? Oui, mais de science-fiction seulement, disons une sorte de Kafka nain et obsédé par les gadgets futuristes inutiles ? Mais, attention toutefois, il n'y a nul mépris pour la littérature d'anticipation dans ce que j'écris: c'est tout le contraire, et je n'ai pas honte de dire que j'ai lu longuement, avidement, passionnément, Dick, Le Guin ou Herbert, avant, bien avant, Proust, Balzac, Flaubert ou n'importe qui d'autre, en délaissant même ces derniers, à l'heure où je commençais de les découvrir, pour les premiers, à mes yeux magiquement auréolés d'un prestige unique, mystérieux. C'est qu'il y a une continuité secrète entre ces auteurs, la plupart américains, la plupart “mineurs”, et, il est vrai, la plupart souvent grossiers aligneurs de navets, et ceux, tourmentés, mystérieux, secs comme des sarments plantés dans du calcaire, que l'on appelle les génies de la Littérature: comme si la science-fiction n'était pas, d'abord mais obscurément, un des visages de celle-ci, visage déformé oui, mais pas moins identique; c'est le secret insigne de l'écriture cela, d'être valable et reconnaissable sous n'importe quel visage !
Cette continuité, c'est bien celle du cauchemar, monstrueux et multiple, qui n'a que faire des barrières universitaires prétentieusement érigées entre “genres”, “styles”, “écoles” ou “époques”, hydre sans forme, douloureux miroir cependant dans lequel un Poe, un Kafka, un Faulkner, un Villiers de l'Isle-Adam, un Sabato peuvent apercevoir le visage d'un Dick ou d'un Brunner, d'un Ballard ou d'un Wolfe.
Seuls nous intéressent les écrivains qui nous peignent la toile terrifiante de leurs cauchemars.

Pour cette peinture hallucinée, Philip K. Dick est un maître sans pareil, très subtil, presque diabolique, tant il s'amuse avec son lecteur, le mène là où il le veut, dans une paradoxale réalité qui ressemble trait pour trait à celle qui lui est familière, qui pourtant n'est absolument pas la même, qui pourtant est radicalement différente dans sa plus certaine et angoissante proximité familière: c'est dans la banalité même que, dans l'oeuvre dickienne, se tapit le Mal, c'est-à-dire — proposons ici une première définition, certes réductrice —, l'illusion, le prestige, le simulacre.
Car, si l'on entre dans l'étrange par une petite porte, habilement dissimulée, d'ordinaire, par l'écrivain, c'est sans s'en rendre compte que l'on pénètre dans la fausse réalité de Dick: il s'agit d'un glissement, non d'un passage, car aucun seuil symbolique ne vous indique qu'il y avait là — mais où donc ?, est-ce comme une coupure existant dans l'espace, ou plutôt dans le temps, à moins que ce ne soit dans l'esprit même du personnage (comme l'illustre la vertigineuse mise en abîme de L'Oeil dans le Ciel) ?; peut-être encore cette faille est-elle inscrite insidieusement dans la réalité, ou alors, ignoble et dérangeante supposition, dans le simple fait de tenir une plume et de se mettre à conter une histoire, (voir ainsi le texte de Dick intitulé Comment construire un univers..., dans le tome premier de ses nouvelles, Le Crâne) ? —, qu'il y avait là une frontière, qu'il y avait là une borne marquant très précisément une limite à ne pas franchir, sous peine de se livrer corps et âme au souffle de l'inconnu.
C'est ce qui arrive au personnage d'une nouvelle intitulée Le Banlieusard, ridiculement et rigoureusement le plus banal des hommes, un monstre de quotidienneté malsaine et d'originalité horlogère, qui, foi de méthodique satrape de l'ennui, a changé d'univers en montant dans ce train maudit: le ton, chez l'auteur, est comique, mais ce ne sera pas toujours le cas et puis, sous le rire, ne sait-on point que se cache parfois l'horreur, surtout dans l'univers détraqué de Dick ? On n'entre donc pas dans l'horreur sous les fanfares, ou plus prosaïquement, sous un linteau qui, comme chez Dante, nous avertirait que l'endroit convoité est très mal fréquenté: chez Dick, tout se passe le plus simplement du monde, et c'est déjà une image que d'écrire le mot “passage”. En fait, celui-ci n'existe pas, car il n'y pas de cauchemar “en soi”, comme séparé de notre univers miraculeusement rassurant, comme dressé face à nous, et prêt à nous dévorer: le cauchemar, le monde absurde du tout-à-l'envers est déjà présent dans notre réalité, est peut-être même son visage secret, son dessous de masque commun, qui apparemment et contre toute logique, à moins qu'il ne s'agisse là de logique absolu, celle du rêve justement, décide de mettre à nu le dessous de table, impudiquement et fort dangereusement.
C'est qu'il y a du tragique dans la farce, dans la mauvaise plaisanterie que nous joue l'auteur: que nous importerait de fouler, sans même nous en apercevoir, les premiers mètres du territoire du plus inquiétant pays de l'étrange, il y aurait même quelque solide dépaysement à le faire, si nous étions assurés de la pérennité de notre santé psychique, si nous étions certains de ne pas remarquer de changement notable dans notre douillet matelas d'habitudes ? Or, le bât blesse, puisque ce petit voyage, éminemment risqué et qui va sans conteste chambouler nos plus solides repères, est truqué: les dés sont pipés, car toujours un vilain gredin, un événement bizarre et révélateur, un indice irrécusable vous feront soupçonner que la réalité dans laquelle n'est pas vraiment celle à laquelle vous étiez accoutumée. Chez Dick, la réalité quotidienne cède bien vite le pas à une réalité différente, et seul un indice infime et ridicule fera mesurer la radicale altérité de cet Autre dans lequel désormais vous vivez: le tragique est dans cet indice, dans ce dérisoire objet qui est encore, fantastiquement, un pont avec ce que peut-être vous ne retrouverez plus jamais.
Dans le superbe roman Le Maître du Haut-Château (adapté depuis en série télévisée) pour lequel Dick reçut le prix Hugo en 1962, la plus haute distinction récompensant une oeuvre d'anticipation, c'est un livre écrit par un mystérieux auteur sous l'influence de l'oracle délivré par le Yi-King, qui livrera aux personnages la vérité: le monde dans lequel ils vivent, et qui a vu le triomphe des puissances de l'Axe, n'est pas le vrai, est faux, est illusoire. Dans Ubik, le héros, prisonnier d'un monde où tout se dégrade, comprend d'un coup — lorsqu'il lit certaine inscription griffonnée dans les toilettes,
SAUTEZ DANS L'URINOIR POUR Y CHERCHER DE L'OR.
JE SUIS VIVANT ET VOUS ÊTES MORTS
— la douloureuse vérité: il est mort, et celui avec lequel il désespérait de communiquer, son patron qu'il croyait décédé, est, lui, bien vivant. L'indice est pervers, surtout lorsqu'il s'affuble des oripeaux grandiloquents d'une vérité de pissotière ! Le simulacre est pervers: le mot, d'origine latine, dérivant du verbe simulare, “feindre”, nous indique d'ailleurs assez ostensiblement ce danger.
La réalité est truquée, disions-nous, elle est perfidement différente, mais malaisément caractérisable dans cette différence même: l'indice, certes, existe, mais pas toujours, alors que notre auteur, lui, s'en moque, poursuivant le déroulement implacable de son cauchemar, adoptant le seul point de vue du personnage concerné, hic et nunc, qui vit ce cauchemar, lequel ne peut donc se dépêtrer du filet où il sait qu'il est tombé, à moins que... à moins que l'auteur ne dissipe tous les voiles trompeurs et malins, dans une belle éclaircie romanesque et ridicule — à l'image très certaine de ce happy end hollywoodien concluant la première version, non conforme aux désirs du réalisateur Ridley Scott, du film Blade Runner.
Univers truqué, univers tronqué, illusion, fausse réalité, simulacres, autant de masques du mensonge, autant de masques, en fin de compte, de l'impossibilité de communiquer, et encore moins de dialoguer, entre les personnages ainsi radicalement plantés sur des parallèles qui jamais ne se rencontreront, parqués, comme dans le roman inachevé intitulé Mensonges et Cie, dans les geôles psychotiques de “para-mondes” aux murs infranchissables puisque les secondent les blancs, les parties manquantes du texte. Pour réelle qu'elle soit, la communication qu'a établie Runciter avec son employé mort — voir Ubik —, en plus d'être fragile extraordinairement, et grotesque, se révélera illusoire, comme en témoignent les toutes dernières lignes du roman; nous y reviendrons. Communication impossible ou dérisoire entre les personnages — ici, les modalités de la non-rencontre sont infinies: enfermements, exclusifs l'un de l'autre, pour la population, dus à l'absorption de la drogue “D-liss”, rapidement concurrencée par la drogue “K-priss”, dans Le Dieu venu du Centaure; barrière physique (bien que totalement illusoire) qui sépare la surface du souterrain dans La Vérité avant-dernière; effilochage qui mine la trame du temps dans Glissement de Temps sur Mars; gouffre entre le présent et l'avenir, plus même, entre le présent sordide et l'espérance, par la destruction de l'illusion bénéfique appelée “mercerisme” (sorte de religion, ou plutôt, restauration fragile d'un lien de sympathie entre les êtres inventée par “Mercer”) dans Blade Runner.

Enfermés dans l'îlot solipsiste de leur cauchemar, les personnages de Dick se trouvent confrontés à une inquiétante détérioration de la réalité: un peu comme si, une fois prisonniers du monde parallèle qui semble s'être détaché à tout jamais de la réalité vraie, ils ne pouvaient faire rien d'autre que d'assister, impuissants, à la lente destruction d'un décor qui n'est plus viable dès qu'il s'est désamarré de son point d'ancrage ontologique. A l'angoissante recherche d'une parole qui délivrerait le personnage de sa geôle, s'ajoute donc la crainte que celle-ci ne puisse éclore désormais que dans un monde délabré, rongé par la pourriture, par cette “bistouille” qu'est seul à voir le déficient John Isidore, fragile anti-héros de Blade Runner, tout comme, dans Glissement de Temps sur Mars, Manfred Steiner, schizophrène et autiste, contemple la “rongeasse” qui mine les assises de son univers. En somme, Dick nous donne ici une version originale du personnage inadapté, faible et idiot qui perçoit le lent travail de la destruction, qui voit seul la vérité, l'issue inéluctable réservée à un univers qui méprise la marginalité, la faiblesse, la différence, la lucidité du pauvre d'esprit. Ce trait nous autorise, je crois, à voir dans l'oeuvre dickienne une réelle préoccupation mystique, s'il est vrai que le mystique, le plus souvent, comme maint exemple nous le prouve, est le délaissé, l'ignoré, le pauvre d'esprit, celui dont l'institution ecclésiale se moque: une différence de taille toutefois réside dans le fait que le mystique toujours rejoint Dieu. Rien de tel, bien évidemment, chez Dick.
Un lien évident unit l'impossibilité de communiquer à l'inexorable décrépitude d'une réalité privée de la source vivifiante de la parole, la vision terrible de la destruction, lovée au sein de la création, à l'impossibilité de clamer haut et fort l'avancée du Mal. Il n'y a point de rachat, point de délivrance dans les romans écrits par Dick, absence d'autant plus cruellement ressentie qu'elle paraît submergée par le Mal dont le noyau de lourde opacité commence à se dévoiler à nos yeux. Ce dévoilement, nul doute pourtant qu'il ne soit lui-même un leurre.
Le démoniaque dickien est l'illusoire et le simulacre; il est, plus encore, la difficulté, voire l'impossibilité de communiquer entre des personnages radicalement isolés: dans une telle absence relationnelle, dans une telle privation d'être, se lèvent les forces de la destruction et de la mort, se lève le Mal souverain. Qu'il est malaisé, d'ailleurs, de caractériser absolument, nous le voyons, en disant par exemple qu'il serait privation ou volonté mauvaise, puisqu'il ne semble surgir qu'à partir d'une situation critique dont il va, en somme, exploiter la faille. Sans un bizarre dérèglement du cours normal des choses, le Mal ne surgirait pas. Pourtant, ne peut-on dire que celui-ci réside justement dans cette situation de départ déréglée ?
C'est qu'avec Dick, rien n'est simple et que, toujours, sous le masque qu'on vient d'enlever il y a un autre masque: on ne peut donc, sans erreur d'interprétation, identifier avec certitude la nature du dérèglement, personnifier ce Mal en telle ou telle entité démoniaque. C'est même tout le contraire qui se produit car, au fur et à mesure que nous croyons nous approcher de cet hypothétique centre du désordre dickien, nous est refusée une identité révélable: le Mal se dissout, et derrière le voile trompeur, ne se cache pas, frustrant ainsi notre attente, un visage, même hideux, mais... rien... ou plutôt, tout, puisque dans cette perpétuelle dérobade se lit la construction et la progression romanesques: les ouvrages de l'écrivain se nourrissent de l'absence même qui devrait les diluer irrémédiablement; puisque le Mal encore, dans ces romans, qui n'est rien de quantifiable, qui n'est rien d'identifiable, pourtant s'amuse à jouir d'une inquiétante plénitude, semble une entité omnisciente et omniprésente, un dieu mauvais, ou plutôt une idole perverse — voir la nouvelle Le grand O, dans le tome deuxième des nouvelles. La dernière exergue d'Ubik en témoigne, elle qui fait résonner dans le vide la parole inquiétante d'on ne sait quoi: Dieu ?, mais alors définitivement dilué, à moins que ne soit là mimé parodiquement le retrait d'un Deus absconditus ? Diable ?, mais alors pas même mauvais, simplement facétieux, grande et puissante force destinale à jamais enveloppée dans les brouillards d'un non-être fumiste :
Je suis Ubik.
Avant que l'univers soit, je suis.
J'ai fait les soleils.
J'ai fait les mondes.
J'ai créé les êtres vivants et les lieux qu'ils habitent;
Je les y ai transportés, je les y ai placés.
Ils vont où je veux, ils font ce que je dis.
Je suis le mot et mon nom n'est jamais prononcé,
Le nom qui n'est connu de personne.
Je suis appelé Ubik, mais ce n'est pas mon nom.
Je suis.
Je serai toujours.

Mais peut-être que nous n'avons pas encore vraiment découvert ce qu'est le Mal dickien si nous disons de lui qu'il est un non-être facétieux, ou une entité absolument présente en tout lieu, justement parce qu'elle se résout en fin de compte à une pure absence ubiquitaire, ou encore illusion et simulacre. En dernier ressort, dans une figure qui résume toutes les autres, le Mal est la chute: non point celle, trop chrétienne, qui nous ferait tomber dans l'Enfer, mais celle, plus moderne, d'une radicale impossibilité de trouver une assise, un fondement, un noyau stable et rassurant de solide et vraie réalité.
Chez Dick, crever une enveloppe d'apparences ne signifie rien d'autre que se trouver confronté à une nouvelle, et ainsi de suite, ad infinitum.
Dans Ubik, s'opère ainsi un retournement final: alors que nous suivions jusqu'à présent les tribulations pathétiques d'un mort qui se croyait vivant, les dernières lignes du roman brouillent définitivement les cartes, puisque l'environnement des vivants paraît contaminé par celui des morts. Dans Le Maître du Haut-Château, le fait que quelques personnages ont compris que l'univers dans lequel ils vivent n'est qu'une illusion ne suffit point: Les Sauterelles pèsent lourd, le livre qu'a écrit le “maître du haut-château”, s'il évente la pseudo-réalité ayant vu le triomphe des Allemands, des Italiens et des Japonais, s'il déchire le décor de théâtre dans lequel se traînent les personnages, ne permet toutefois pas d'imaginer ce que serait le lieu d'une rassurante vérité, puisque le monde qu'il dépeint, proche de l'Histoire telle que nous la connaissons, n'est pourtant pas le nôtre, tout comme dans la nouvelle intitulée Reconstitution historique (tome quatrième des nouvelles de Dick intitulé Un auteur éminent). Alors le héros de Dick, abandonné des derniers dieux dont il vient de crever l'enflure, dont il vient de dissiper la fumée qui rendait imprécises, mais ô combien tentatrices, les formes d'une Réalité ultime qui ne s'avère être, elle aussi, qu'un leurre, se retrouve, comme l'évoque le cliché nihiliste, au milieu de nulle part, condamné à l'errance, comme une espèce d'Angélus Silesius qui aurait perdu de vue la trace négative de son Dieu caché, mais, Lui, bien réel.
Un dossier de Juan Asensio.
SES PRINCIPAUX ROMANS
- Ubik (roman, 1969)
Collection 10/18, 1999. Traduction américaine par Alain Dorémieux. Ubik est conjointement avec Total Recall et Blade Runner, un des principaux chefs d’œuvre de Philip K. Dick, paru pour la première fois en 1969.
- Deus Irae (roman écrit en collaboration avec Roger Zelazny, 1976, 1977)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°238.
- Substance mort (roman, 1977, 1978)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°252.
- SIVA (roman, 1980, 1981)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°317.
- L'invasion divine (roman, 1981, 1982)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°338.
- La transmigration de Timothy Archer (roman, 1982, 1983)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°356.
- Radio libre albemuth (roman, 1985, 1988)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°444.
- Le Grand O (nouvelles, 1987, 1988)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°471.
- Au service du maître (nouvelles, 1987, 1989)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°497.
- Le Voyage gelé (nouvelles, 1987, 1998)
Éditions Denoël, collection Présence du Futur, n°510.
PRINCIPALES ADAPTATIONS AU CINEMA
Blade Runner (id.), Ridley Scott, 1982.
Adaptation du roman "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1967).
Total Recall (id.), Paul Verhoeven, 1989.
Adaptation d'après la nouvelle "We Can Remember It For You Wholesale"
Confessions d'un barjo, Jérôme Boivin, 1991, France.
Screamers, Christian Dugay, 1995, Canada/USA/Japon
D'après la nouvelle "Type 2 / Second Variety"
A Scanner Darkly (id.), 2006, Richard Linklater, Etats-Unis
D'après le roman Substance Mort

Total Recall (id.), Paul Verhoeven, 1989.

Le maître du haut château (série)

A Scanner Darkly (2006), adaptation du roman Substance Mort
BOUTIQUE
COMMENTAIRES

VOS AVIS (1)

BOUTIQUE SF-STORY EN PARTENARIAT AVEC

Chers visiteurs, chères visiteuses…
Nous avons créé ce site avec passion pour vous offrir des informations sur les films 🤖 fantastiques et de 🛸 science-fiction.
Pour nous aider à faire vivre SFStory, tous vos achats par l'intermédiaire des liens images ci-dessous, nous permettrons de boire quelques 🍺bières mais nous aiderons surtout à développer le site pour continuer à répondre à vos attentes.
Un grand merci d'avance pour votre soutien !
Rechercher sur SFStory :
SFSTORY - Cent ans de cinéma de science-fiction
Toutes les photographies et jaquettes de ce site web sont protégées par les lois sur le copyright. Tous documents visuels de ce site sauf mentions particulières sont la propriété des auteurs ou des studios de cinéma respectifs. Vous n'êtes autorisés à télécharger et à imprimer tous les documents visuels que pour une utilisation dans le cadre privé. Pour les jaquettes (covers), uniquement dans le cadre d'un remplacement d'un original perdu ou détérioré. L'éditeur de ce site ainsi que son hébergeur ne sauraient être tenus pour responsable d'une utilisation autre que celle prévue dans cette mise en garde.
Les textes du site sauf mentions particulières du nom de l'auteur de certains articles ou critiques sont la propriété du sitemestre.
Les liens externes pour des sociétés ou des sites à caractères commerciaux ne sont là que pour vous informer de la possibilité de visionner les livres, films ou séries TV nommés. SF-Story ne peut être tenu responsable des transactions effectuées à partir de ces liens. Vous devez accepter ces conditions pour accéder au site.
SF Story n'a qu'un seul but : vous faire apprécier le cinéma de science-fiction!
SFStory - Cent ans de cinéma de science-fiction